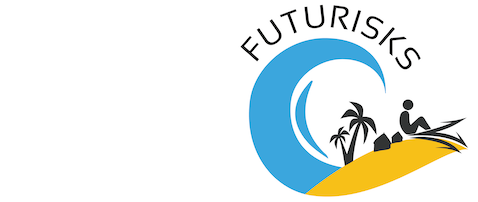Mirna BADILLO
Une approche intégrée pour évaluer l’impact des risques climatiques composés dans le contexte des petites îles (2023-2026 ; WP1/WP3/WP4)
Encadrant(s): Virginie Duvat, Professeure de Géographie côtière à La Rochelle Université, LIENSs ; Gonéri Le Cozannet, Chercheur au BRGM ; Jérémy Rohmer, Chercheur au BRGM
Financement: 100% FUTURISKS
Les îles d’atoll seront de plus en plus impactées par des changements liés au climat, tels que l’élévation du niveau marin, l’augmentation des températures et l’acidification des océans. Ces changements affecteront simultanément de multiples dimensions des systèmes insulaires (environnementales, sociales et économiques), compromettant ainsi leur résilience. Cette thèse a pour objectif de mieux comprendre les interactions complexes entre les facteurs climatiques et non climatiques qui influencent l’habitabilité de ces îles. Elle propose le développement d’un modèle intégré, basé sur des réseaux bayésiens, pour évaluer l’impact futur du changement climatique sur des dimensions essentielles pour l’habitabilité (Duvat et al., 2021), telles que la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau douce, la disponibilité de terres habitables et les activités économiques.
© Comme un accord / Eva Boissonnade-Boyer
Lila BAHROUN
Submersions marines dans les systèmes récifaux et lagonaires d'outre-mer : modélisation numérique et mesures in situ des niveaux d'eau (2025-2028 ; WP2)
Encadrant(s): Héloïse Michaud, chercheure au SHOM, Frédéric Bouchette, Professeur à l’Université de Montpellier, Géosciences Montpellier, et Yann Krien, maître de conférence, LEGOS)
Financement: 50% FUTURISKS + 40% SHOM + 10% Géosciences Montpellier


Plage de l’Hermitage-les-Bains (photo de Mai-Linh Doan)
Johanna BARROS
La relocalisation des biens et des activités face aux risques côtiers d’érosion et de submersion marine en Martinique et en Guadeloupe : de l’opérationnalisation des politiques à leur réception sociale (2024-2027 ; WP4)

Encadrant(s): Catherine MEUR-FEREC, Professeure de Géographie, Université de Bretagne Occidentale, LETG ; Carola KLOECK, Professeure de Sciences politique à Sciences Po Paris, CERI
Financement:
Face à l’aggravation des risques d’érosion côtière et de submersion marine dans les Antilles françaises, la relocalisation apparaît comme une solution d’adaptation de plus en plus discutée. Cette stratégie de repli des biens exposés, encore marginale, soulève cependant de nombreuses tensions juridiques, sociales, politiques et territoriales, particulièrement dans les contextes insulaires. En Martinique et en Guadeloupe, les contraintes foncières liées à la littoralisation, à la spécificité de la bande des 50 pas géométriques – héritage colonial où de nombreux habitants vivent sans titre légal de propriété – complexifient la mise en œuvre de cette stratégie.
Cette thèse analyse comment la relocalisation est mise en œuvre concrètement en Guadeloupe et en Martinique, à travers différents dispositifs (résorption de l’habitat insalubre, projets pilotes, initiatives locales) et à différents stades d’avancement. Elle s’intéresse à la manière dont les habitants reçoivent, contestent ou s’approprient ces politiques, au prisme de leurs expériences, de leurs représentations du risque, de leurs trajectoires résidentielles et de leur rapport aux institutions.
En croisant l’étude des cadres institutionnels et l’analyse de la réception sociale, cette recherche vise à éclairer les conditions dans lesquelles la relocalisation peut devenir une réponse légitime et soutenable aux défis croissants de l’adaptation côtière dans les territoires ultramarins

Quartier de Bel-Air exposé à l’érosion de Falaise, Petit-Bourg, Guadeloupe (Photo Mairie de Petit-Bourg)
Axelle GAFFET
Contributions des houles distantes exceptionnelles aux évènements de submersion marine extrêmes passés dans les Territoires Français d'Outre-mer (2022-2025 ; WP2)
Encadrant(s): Xavier Bertin, Directeur de recherche au CNRS, La Rochelle Université, LIENSs ; Damien Sous, Maître de Conférences àUniversité de Pau et des pays de l’Adour, SIAME ; Gaëtan Dufour, Chef de projet à Créocéan
Financement: 100% CIFRE CREOCEAN
Du fait de la concentration des populations et des activités associées dans les zones littorales, de l’augmentation des aléas littoraux et de la dégradation des récifs coralliens liées aux changements globaux, les îles tropicales vont faire face à une augmentation alarmante des risques littoraux dans les décennies à venir. Les évènements majeurs de submersion peuvent se produire à la suite d’un cyclone tropical mais également à la faveur de houles distantes exceptionnelles, phénomène jusqu’alors peu connu. Au cours de la dernière décennie, la compréhension de la contribution des vagues dans les niveaux marins extrêmes a énormément progressé, grâce à des études combinant des observations de terrain et des simulations numériques à haute résolution. Les états de mer tropicaux doivent être mieux représentés et les évènements majeurs ayant eu lieu au cours des décennies passées doivent être revisités, afin de mieux comprendre et de quantifier l’importance du setup et des ondes infragravitaires dans les submersions marines associées.
© Comme un accord / Eva Boissonnade-Boyer
Mila GEINDRE
Processus de transformation des vagues en contexte tropical (2023-2026 ; WP2)
Encadrant(s): France FLOC’H, Maître de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale, Geo-Ocean (UMR 6538) ; Damien SOUS, Maître de conférences à l’école d’ingénieurs SeaTech et chercheur à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO) de l’Université de Toulon
Financement: 50% FUTURISKS + 50% UBO
Cette thèse a pour objectif d’améliorer la paramétrisation spectrale des principaux processus intervenant dans la transformation des vagues sur les récifs coralliens, à partir de données d’observation. Elle se concentre notamment sur la friction, le déferlement et les transferts non linéaires d’énergie. Ces processus sont étroitement liés à l’hydrodynamique des vagues incidentes (hauteur, période, profondeur d’eau, etc.) ainsi qu’aux caractéristiques géomorphologiques multi-échelles des systèmes récifaux (type de formation, pente, rugosité, couverture benthique, etc.).
© Comme un accord / Eva Boissonnade-Boyer
Maëlys GIRAULT
L’intérêt d’une approche Passé-Futur pour soutenir l’adaptation côtière au changement climatique : application aux îles françaises du Pacifique (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française)
Encadrant(s): Virginie Duvat, Professeure de Géographie côtière à La Rochelle Université, LIENSs ; Alexandre Magnan, Chercheur à Cawthron Institute
Financement: 100% FUTURISKS
La thèse cherche à démontrer l’importance d’ancrer l’adaptation au changement climatique dans l’épaisseur historique des territoires à travers deux volets : la reconstruction des Trajectoires d’exposition et de vulnérabilité et l’analyse des barrières structurelles et long-termes à la gouvernance de l’adaptation. Cet effort de contextualisation profonde doit être la garantie d’une adaptation juste et ancrée dans les spécificités territoriales. L’analyse se concentre sur la gestion des risques côtiers actuels et futurs d’érosion, de submersion marine, d’inondation, et de combinaison de ces pressions dans deux territoires français du Pacifique : la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française.
© Comme un accord / Eva Boissonnade-Boyer
Alice JACOBEE
L’habitabilité socio-culturelle pour s’adapter au changement climatique sur les littoraux de Nouvelle-Calédonie

Encadrant(s): Virginie Duvat, Professeure de Géographie côtière à La Rochelle Université, LIENSs ; Alexandre Magnan, Chercheur à Cawthron Institute
Financement: 100% ADEME

Pêche vivrière à l’épervier à Poindimié (Côte Est, Nouvelle-Calédonie), Jacobée 2025
Lola ORMIERES
Analyse des surcotes et submersions marines liées aux cyclones dans les îles tropicales françaises au cours des 4 dernières décennies (2023-2026 ; WP2)
Encadrant(s): Xavier Bertin, Directeur de recherche au CNRS, La Rochelle Université, LIENSs ; Franck Dollique, Professeur à l’Université des Antilles – IRD – BOREA MNHN ; Yann Krien, Maître de conférence, LEGOS
Financement: 100% FUTURISKS
Alors que les îles tropicales font face à des risques croissants liés aux niveaux marins extrêmes et à la submersion marine, sous l’effet combiné du changement climatique, de l’élévation du niveau de la mer, de la possible intensification des cyclones, de la dégradation des récifs coralliens et, pour certaines, de la subsidence, cette thèse vise à mieux comprendre les processus physiques à l’origine de ces risques côtiers. Si la surcote atmosphérique peut être estimée de manière relativement fiable à partir de réanalyse atmosphériques, la contribution de la dissipation de l’énergie des vagues au niveau moyen de la mer à la côte reste difficile à quantifier. Cela s’explique notamment par la morphologie complexe de ces îles, caractérisées par de fortes pentes bathymétriques et des fonds rugueux associés à la présence de récifs, entraînant des interactions vagues-courants spécifiques et encore mal comprises. En s’appuyant sur des données issues de campagnes de terrain récentes (Mayotte 2023, Guadeloupe 2017), le projet analysera les processus physiques influençant les niveaux moyens d’eau à la côte lors d’événements extrêmes passés, à l’aide d’une modélisation couplée vague–hydrodynamique.
© Comme un accord / Eva Boissonnade-Boyer
Anni SCHLÜTER
Evolutions des risques de submersion marine dans les iles tropicales françaises au cours du 21ème siècle
Encadrant(s): Xavier Bertin, Directeur de recherche au CNRS, La Rochelle Université, LIENSs ; Kevin Martin, Chargé de recherche au CNRS, LIENSs ; Virginie Duvat, Professeure de Géographie côtière à La Rochelle Université, LIENSs
Financement: 50% FUTURISKS + 50% La Rochelle Université
Cette thèse de doctorat étudie l’évolution des risques de submersion marine dans les îles tropicales françaises, fortement exposées aux aléas météo-océaniques et en première ligne face aux impacts du changement climatique. À partir des résultats du projet FUTURISKS, les principaux événements de submersion observés au cours des dernières décennies seront réexaminés à l’horizon de la fin du XXIᵉ siècle, en tenant compte de l’élévation du niveau marin, de l’affaissement naturelle des iles, de la dégradation des récifs coralliens et des stocks sédimentaires, de l’évolution des régimes de cyclones et de houles distantes, ainsi que des solutions d’adaptation fondées sur la nature. Les sites d’étude retenus, présentant des configurations récif-lagon contrastées et des expositions variées aux aléas, permettront une quantification plus précise des risques de submersion et contribueront à la conception de stratégies d’adaptation réalistes.
Aline ZRIBI
Représentativité et incertitudes de l’aléa cyclone dans les Territoires Français d’Outre-mer (2023-2026 ; WP1)
Encadrant(s): Xavier Bertin, Directeur de recherche au CNRS, La Rochelle Université, LIENSs ; Swen Jullien, Chercheuse à IFREMER, LOPS ; Guillaume Dodet, Chercheur à IFREMER, LOPS
Financement: 50% FUTURISKS + 50% IFREMER
Les Territoires Français d’Outre-Mer situés en zone tropicale sont particulièrement exposés aux cyclones tropicaux, responsables de vents violents, fortes pluies, vagues extrêmes et submersions marines. Ce sont des phénomènes complexes (aspect stochastique, dynamique fortement couplée, interactions multi-échelles, etc) qui restent difficiles à caractériser, même a posteriori. Cette thèse vise à reconstituer plusieurs événements cycloniques majeurs survenus depuis les années 1980, afin d’en analyser les caractéristiques et d’évaluer les incertitudes associées à l’aléa cyclonique dans ces territoires.
© Comme un accord / Eva Boissonnade-Boyer